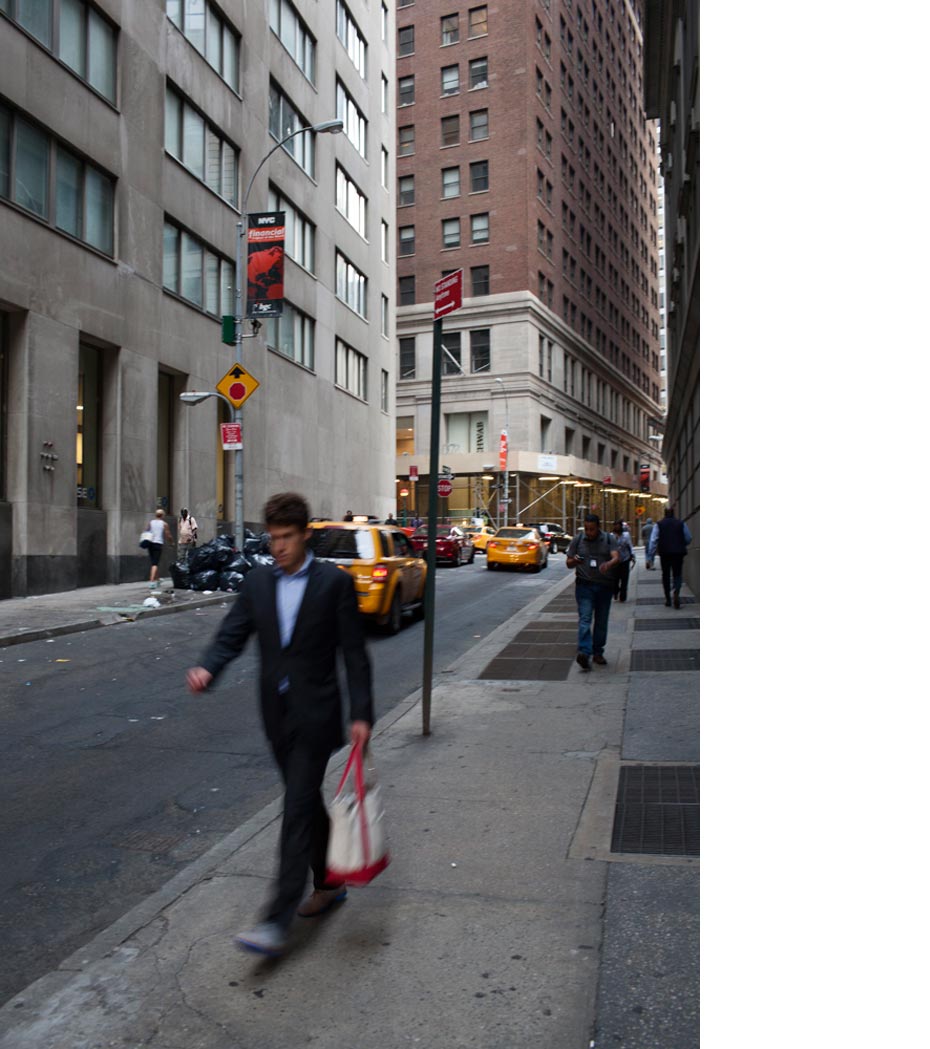Par: Ana Fornaro
Images: Larysa Sendich
Javier voit des sons et écoute des couleurs. Nous sommes à un concert de Phish, un groupe américain mythique, connu pour ses très longs solos. En plein milieu d’une reprise magnifique de Rock and Roll de Lou Reed, ce broker de 38 ans est en pleine expérience multi sensorielle. Il ne connaissait pas cette expression, mais une fois apprise, il eut une révélation. Avec l’enthousiasme d’un enfant -ou celui d’un adulte qui découvrirait que certaines sensations se traduisent en mots - Javier, en extase, dit : « Si voir des sons et écouter des couleurs c’est de la synesthésie, et bien j’ai passé toute ma putain de vie comme ça. » Bon, il exagère un peu. On est samedi et nous sommes sur une île, dans la banlieue de Manhattan, parmi des milliers de pèlerins qui jouent à Woodstock. On peut voir des draps étendus sur l’herbe, des ballons colorés et des gens en train de faire des petites danses lysergiques. Vu le style de ces gens, je parierais ma vie ou, au moins, un doigt du pied, que la plupart d’entre eux adhère au mouvement de protestation Occupy Wall Street. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que parmi eux, profitant aussi des synesthésies, se trouvent au moins quatre membres actifs du système financier qu’ils veulent défenestrer. C’est parmi eux que je me trouve, invitée spéciale au côté obscur de la force. Je regarde le coucher de soleil, hypnotisée par les lumières de la scène, et j’écoute une musique qui nous rend heureux. Tous.
Au moment de la couverture journalistique du dernier sursaut du litige entre l’Argentine et les fonds vautour, d’une semaine marquée par deux négociations infructueuses à New York, de tirs croisés entre les spéculateurs et un pays qui joue la restructuration de sa dette, on m’a demandé de rédiger une chronique sur « le monde vautour ». J’ai dit que j’acceptais, bien-sûr. Ce que je ne savais pas, même si je m’en doutais, c’était que ce serait mission impossible. Après avoir passé de longues heures à Park Avenue, devant le bureau du médiateur Daniel Pollack, d’où les protagonistes sont entrés et sortis sans rien me dire, après avoir envoyé des dizaines de mails restés sans réponse, m’être fait claquer des portes au nez, après que des porte-paroles m’aient envoyée voir des attachés de presse et que les attachés de presse m’aient envoyée balader, je me suis rendue compte que les vautours sont inaccessibles : ce sont des fantômes superpuissants, protégés par des avocats, aussi invisibles et téméraires qu’eux.
Les avocats et les économistes m’expliquaient en détail comment les vautours avaient gravement mis en danger plusieurs pays du tiers-monde, en spéculant sur leurs dettes souveraines, se faisant payer à prix d’or des bons achetés pour presque rien. Leurs propos ont confirmé mes soupçons. « Ces gens sont blindés », m’a raconté en ces temps-là le journaliste et avocat Michael Goldhaber, une autorité en matière de fonds vautour et, en particulier, fin connaisseur du cas argentin. « Pour toutes mes recherches et mes articles sur ce cas, je n’ai réussi qu’une seule fois à parler à Jay Newman, qui fait partie du groupe Elliot. »
Il a fallu que je me rende à l’évidence : mes chances réelles d’accéder au milieu de Elliot Management ou d’Aurelius Capital étaient aussi minces que de croiser Robert Downey Jr sur la Cinquième Avenue, croiser son regard, qu’il tombe amoureux de moi instantanément et m’invite chez lui.
Alors j’ai fait ce que n’importe quelle groupie aurait fait : si ce n’est pas possible de voyager avec le groupe, voyageons au moins avec leurs voisins. Ils auront bien quelque chose à me raconter. À défaut de n’avoir pu trouver les vautours, je suis partie à la recherche des loups de Wall Street.
Tout a commencé dans un bateau ancré dans le fleuve Hudson, dans lequel il y a un bar qui bat son pleinpendant l’été new-yorkais. Nous sommes jeudi et je suis invitée à un « after office » pour pouvoir faire connaissance avec des gens du « métier », comme aiment s’appeler ceux qui travaillent dans le monde financier. Le soleil tape encore et je suis en train de relire ma liste de questions -techniques, ridicules- dans mon carnet, en faisant une file d’attente longue de trois pâtés de maisons pour pouvoir traverser le quai et entrer dans le bar. C’est là que je dois retrouver mon groupe. Moi qui m’attendais à trouver le despote Michael Douglas, ce drogué de Leonardo di Caprio ou Christian Bale et sa tronçonneuse, ce sont en fait des garçons sympathiques, qui font leurs premiers pas dans la Grande Pomme qui m’attendent. Ce sont des financiers imberbes, certains d’entre eux viennent juste d’arriver en ville et se mettent au courant des exigences de Wall Street. Un peu déçue, je me rends compte que j’arrive trop tard. Les loups, les vrais de vrai, n’existent plus ou, en tout cas, ne fréquentent pas des bars branchés dans des bateaux avec vue sur le New Jersey. C’est cela que je me dis pendant que, nerveuse, j’avale rapidement une première gorgée de bière, résignée à l’idée que la conversation ne portera pas sur le sexe, les drogues ou les marchés de capitaux, mais plutôt sur le Mondial de football. Mais il se passe quand même quelque chose.
Joshua, le seul new-yorkais autochtone du groupe, un financier de 35 ans, aussi beau et propre que Ken, s’approche de moi, curieux. Je lui raconte pourquoi je suis là, les vautours, les négociations avec l’Argentine, la couverture journalistique, et je lui dis que je veux savoir ce que « vous » en pensez. « Ce n’est pas une mauvaise chose que ces groupes existent, me répond-il. Cela nous est égal. Ils achètent à l’étranger et donnent de la fluidité à un marché de la dette en difficulté.C’est ce qui fait qu’il y a des prix intermédiaireset un équilibre de la place. Pour le reste, il s’agit de questions morales. Mais ce qu’ils font est légal ». Joshua ne connaît pas en détail le litige entre l’Argentine et les fonds qui ont plaidé contre le pays devant le tribunal de Thomas Griesa, mais il répond à mes questions aimablement et il parle des vautours -les « hedge-funds », c’est comme cela qu’on appelle les fonds à hauts risques- avec la prudence de celui qui travaille dans le marché depuis plus de dix ans. Il a commencé très jeune, comme tout le monde dans ce métier, et il est « trader » dans une banque importante. Sa vie consiste à acheter et à vendre des bons, des actions et toutes sortes d’instruments financiers du marché.
Mais il veut partir. Il ne supporte plus Wall Street ni le rythme imposé par la ville. La pression est trop forte. Faire carrière peut mener à des situations extrêmes. En plus, dit-il, depuis la crise de 2008 ils sont traités comme des délinquants. Il veut déménager en Amérique latine, mais cela lui fait peur. Peur de gagner moins d’argent- en tant qu’homme, il doit être le pourvoyeur-peur de se perdre. Ou de se trouver. Il a été élevé dans une famille riche, très conservatrice, et il est devenu tout ce qu’on attendait de lui. Et cela ne donne pas toujours de bons résultats. « Je pourrais t’expliquer comment cela fonctionne, mais ce monde-là est tellement abstrait qu’il n’a plus rien à voir avec le travail. Ni même avec l’argent. Ici, tout tourne autour des relations personnelles. Les affaires dépendent de si on t’emmène dîner ou en voyage, si on te présente des putes. Tout est une question de charisme. Si tu veux vraiment savoir comment on vit à Wall Street, il faut que tu rencontres Javier. Lui, c’est un broker, un très bon. Tout un personnage. Je le préviens que tu vas l’appeler. »
Quand il avait 19 ans, Javier a eu un accident de moto et il est mort. Pendant cette mort, il s’est vu depuis là-haut dans son lit d’hôpital. Il a vécu ça comme un voyage astral. Il a gardé de cet épisode une cicatrice qui lui traverse l’abdomen et la certitude que, s’il ne s’arrête pas un peu, il peut mourir à nouveau à tout moment. Il a commencé à travailler dans le métier à 16 ans, après s’être fait renvoyer de l’école pour la énième fois. Son père, un « trader » espagnol qu’il ne voyait jamais, après s’être rendu compte que son fils devenait un petit délinquant, lui a obtenu un poste subalterne dans sa banque. Et il l’a sauvé. Ou pas. « Je fais probablement partie de la dernière génération de brokers qui n’a pas fait d’études. J’ai commencé en tant que préposé au tableau noir de cotation.À cette époque il n’y avait pas de marchés électroniques. On s’appelait au téléphone, on confirmait par télex. De la folie. Depuis ce moment-là, je ne me suis jamais arrêté. Je ne sais pas faire autre chose. Je ne connais que ce monde-là. »
Javier parle sans arrêt, avec une voix cassée. Il est extraverti, sympathique, drôle : un bulldozer compact d’un mètre soixante-dix, possédant tous les attributs nécessaires pour séduire les clients et les satisfaire. Et c’est ce qu’il fait en ce samedi après-midi, dans un bar coquet du quartier coquet de Soho, quelques heures avant le concert de Phish, la reprise de Lou Reed, et son expérience synesthésique. Cet Espagnol est un intermédiaire entre banques. C’est lui qu’ils appellent quand ils ont besoin d’acheter des instruments financiers,et s’ils ont besoin de connaître l’état du marché avant de faire quoi que ce soit. C’est donc lui qui communique avec le reste des trésoreries bancaires, et qui après, conseille à ses clients le meilleur type de transaction possible, les meilleurs placements à faire et jusqu’à quand, tant que le taux de change ne varie pas.L’entreprise pour laquelle il travaille, opère à des montants qui oscillent entre 3 et 5 millions de dollars. Et il se fait payer une commission pour chaque million. Cela fait 22 ans qu’il y travaille et son rythme de vie c’est des journées de 20 heures et des semaines sans fin. Parce qu’on travaille aussi les samedis et les dimanches. Aujourd’hui il a invité à manger Sebastián et Bárbara, un couple de Chiliens charmants : lui est « trader » et client de Javier, elle est architecte et aussi son accompagnatrice dans cette question des relations publiques financières.
Dans sa banque, Sebastián est un spécialiste des taux d’intérêt et de « local currency » (monnaie du commerce dans une région délimitée, l’Amérique Latine dans son cas). Les dettes en monnaie locale sont changées en bons à l’étranger. Une fois émise, la dette se retrouve sur le marché, entre vendeurs et acheteurs -c’est là qu’interviendrait Javier-, qui peuvent être les hedge-funds.
« Hedge-funds », comme par exemple Elliott Associates L.P, Dart ou Aurelius Capital, quelques-uns des fonds en conflit avec l’Argentine, lui commenta-t-il en passant. Mais Sebastián fait la distinction :
« Il y a les « hedge-funds » qui effectuent des opérations avec les entreprises, et après il y a ceux qui achètent des bons de dettes, comme les vautours. Mais là, c’est plutôt des groupes d’avocats qu’autre chose. Il faut les différencier. Moi, je n’ai aucune relation avec ce type de fonds. »
« Des groupes d’avocats », c’est la phrase qu’on me répond le plus souvent quand je demande aux gens du « métier » de me parler des fonds vautours.
Pendant que sur notre table, « sangrías » et « tapas » continuent de circuler, j’essaie de comprendre comment cette sorte de fête, avec des personnes ressemblant plus à des surfeurs qu’à des financiers, peut s’appeler une réunion de travail.
C’est qu’une partie du travail de Javier consiste à distraire, gagner la confiance de ses clients et les traiter comme ses amis. Il a même un pourcentage d’argent fixe destiné à ce genre de sorties. Bárbara l’a bien compris. Cela fait deux ans qu’ils ont déménagé à New York et elle a un avis partagé là-dessus : elle en profite et s’en méfie. Les invitations au restaurant, les stations de ski ou les fêtes exclusives sont très séduisantes. Mais il y a des limites, ajoute-t-elle. Et ces limites dépendent de l’éthique de chacun.
« C’est un monde qui convient très bien aux célibataires. A Wall Street, il y a beaucoup de petits jeunes qui arrivent, qui veulent faire carrière et avoir ce genre de vie folle, de prostituées, de fêtes et de drogues, cela marche pour eux. Ils sont seuls, ont un travail très prenant et stressant. Donc je les comprends. Mais quand ils ont déjà une vie de couple ou une famille, cela se complique. Je suppose que c’est difficile de ne pas se perdre. De ne pas se vendre. »
Avec Javier ils s’entendent bien et se font confiance, assure Bárbara, mais ils ne s’inviteraient jamais les uns les autres à dîner à la maison. Une chose est une chose, et un broker, c’est autre chose.
La journée n’est pas finie. Il reste encore un concert à voir -d’autres clients à satisfaire- et on dirait que la nuit va être longue. Allons-y.
Javier a été élevé au milieu de traders et de brokers. Ses meilleurs amis sont les enfants des amis de son père, un homme parti de rien et qui est devenu une éminence du monde de la finance. Peut-être faisait-il partie de la dernière génération des authentiques loups de Wall Street, calcule-t-il. C’est pour cela que l’enfance de Javier s’est déroulée parmi des enfants riches, bien qu’il n’ait jamais fait partie de cette classe sociale. Même si un jour, il a joué au baby-foot avec Felipe II dans une station de ski du nord de l’Espagne.
-J’étais ami avec l’un des gardes du corps du Prince. Il est venu me voir et m’a dit « Felipe dit qu’il te bat au baby-foot ». « Qu’il vienne », j’ai répondu. Et il me semble que j’ai gagné. « J’ai gagné une partie de baby-foot contre le roi d’Espagne »- raconte-t-il en éclatant de rire et devenant le centre de la réunion.
C’était un adolescent à problèmes, et avec à peine une vingtaine d’années, il est parti vivre à Londres presque sans argent. Là-bas il a travaillé dans une petite banque, où il a tout appris. C’est pour cela qu’il connaît si bien l’affaire. C’est l’un des meilleurs dans son domaine, dit-il sans fausse modestie. C’est une personne très intuitive et il arrive à gérer sept conversations à la fois avec des clients. À un moment donné, il fumait trois paquets de cigarettes par jour et un kilo d’herbe par an. Il a arrêté la nicotine. Les joints jamais. C’est la seule chose qui peut le faire descendre.
- Nous sommes esclaves de nos paroles et de nos actes- me dit-il, entre sincérité et paranoïa. À ce moment-là, il se rend compte qu’il parle beaucoup et se rappelle que je suis journaliste.
Il est tombé amoureux trois fois, mais ça n’a pas marché. Les femmes voulaient le changer. « Vous faites toujours ça », me dit-il, comme si j’avais quelque chose à voir là-dedans. Il ne veut pas d’enfants - il ne les verrait jamais, comme lui n’a jamais vu son père- il ne veut ni se ranger, ni vivre une relation qui modifierait son style de vie. Il est propriétaire d’un bar charmant de Soho, l’endroit où nous avons bu les « sangrias », et d’une discothèque. Les rares week-ends où il ne travaille pas, il les passe à faire des voyages de surf ou à visiter ses amis - ses vrais amis, ceux qu’il peut compter sur les doigts de la main - et sa famille aussi. Et apparemment, il ne fait pas grand-chose d’autre. Son travail c’est sa bulle; le seul écosystème dans lequel il peut respirer. Il peut gagner des centaines de milliers de dollars par an, mais il est nul, dit-il, quand il s’agit de gérer ses propres investissements. Dans deux ans, il arrête. Il a peur de mourir. Au fond, dit-il, ce n’est pas une question d’argent. Et moi, je le crois.
Javier ne voit plus de sons et n’écoute plus de couleurs. Le concert et la communion lysergique sont terminés. Et pour la première fois, après huit heures passées avec lui, je lui trouve un air sérieux. Il a l’air inquiet. Avec nous, en plus de Joshua, il y a d’autres jeunes de Wall Street, et le broker est responsable de tous et de chacun. Il doit nous sortir d’une île pleine de milliers de personnes et trouver une voiture ne sera pas chose facile. Mais par magie, il en trouve une. Il convainc un chauffeur de taxi - avec de l’argent, bien-sûr- de prétexter un accident quelconque à son centre de gestion pour annuler une course et se libérer pour nous emmener, nous, qui ne l’avons pas appelé. Alors que nous nous installons dans la voiture pour revenir sains et saufs à Manhattan, le chauffeur expérimente la corruption pour la première fois et un groupe d’inconnus se retrouve sans moyen de transport. Tout est toujours question de l’endroit où l’on se trouve. Et Javier le sait très bien. Le lendemain, à 8 heures du matin, il doit aller jouer au golf avec le super boss d’une super banque. En fin de compte, c’est du travail. Le rêve, c’est fini.
Quand nous nous quittons, il me dit qu’on n’a pas eu assez de temps.
-Aujourd’hui, tu as vu comment je dépense l’argent. Maintenant, il te reste à voir comment je le gagne.
*Traduction non officielle/Traducción no oficial. Traduit par le département de traductions de l’Ambassade Argentine en France/Traducidopor el departamento de traducciones de la Embajada Argentina en Francia.